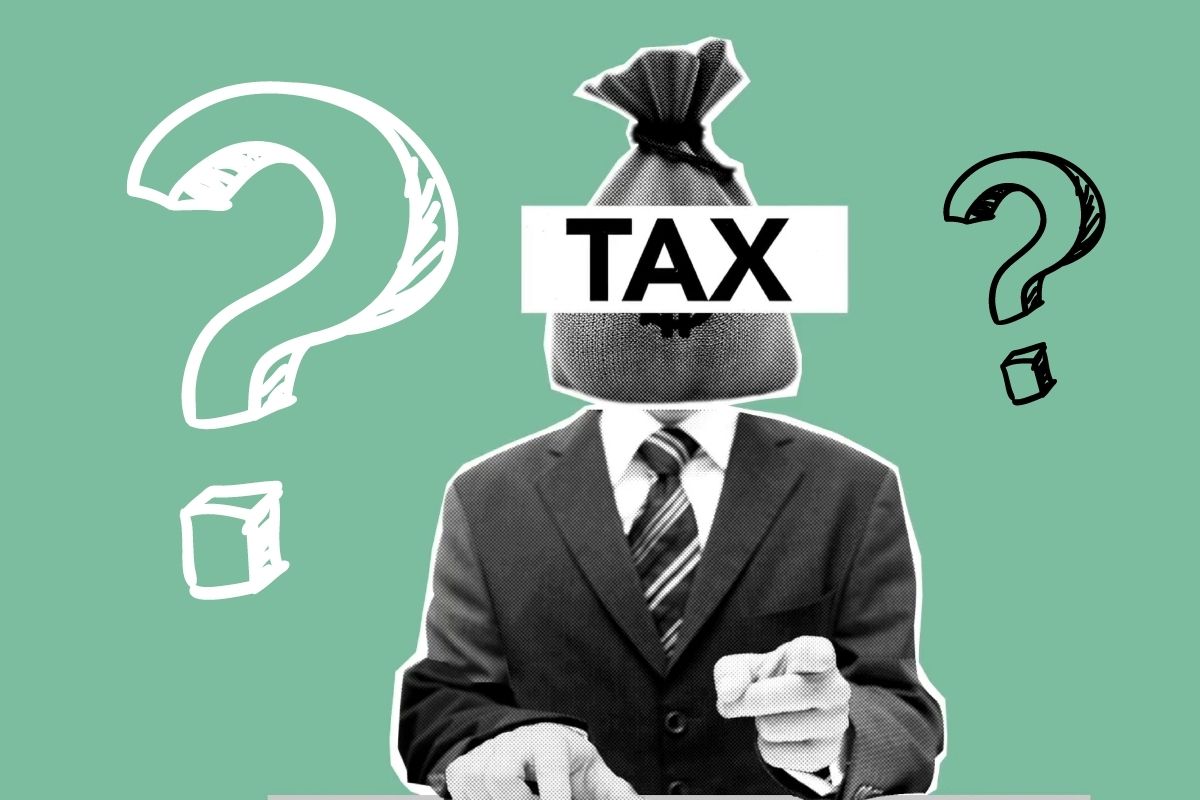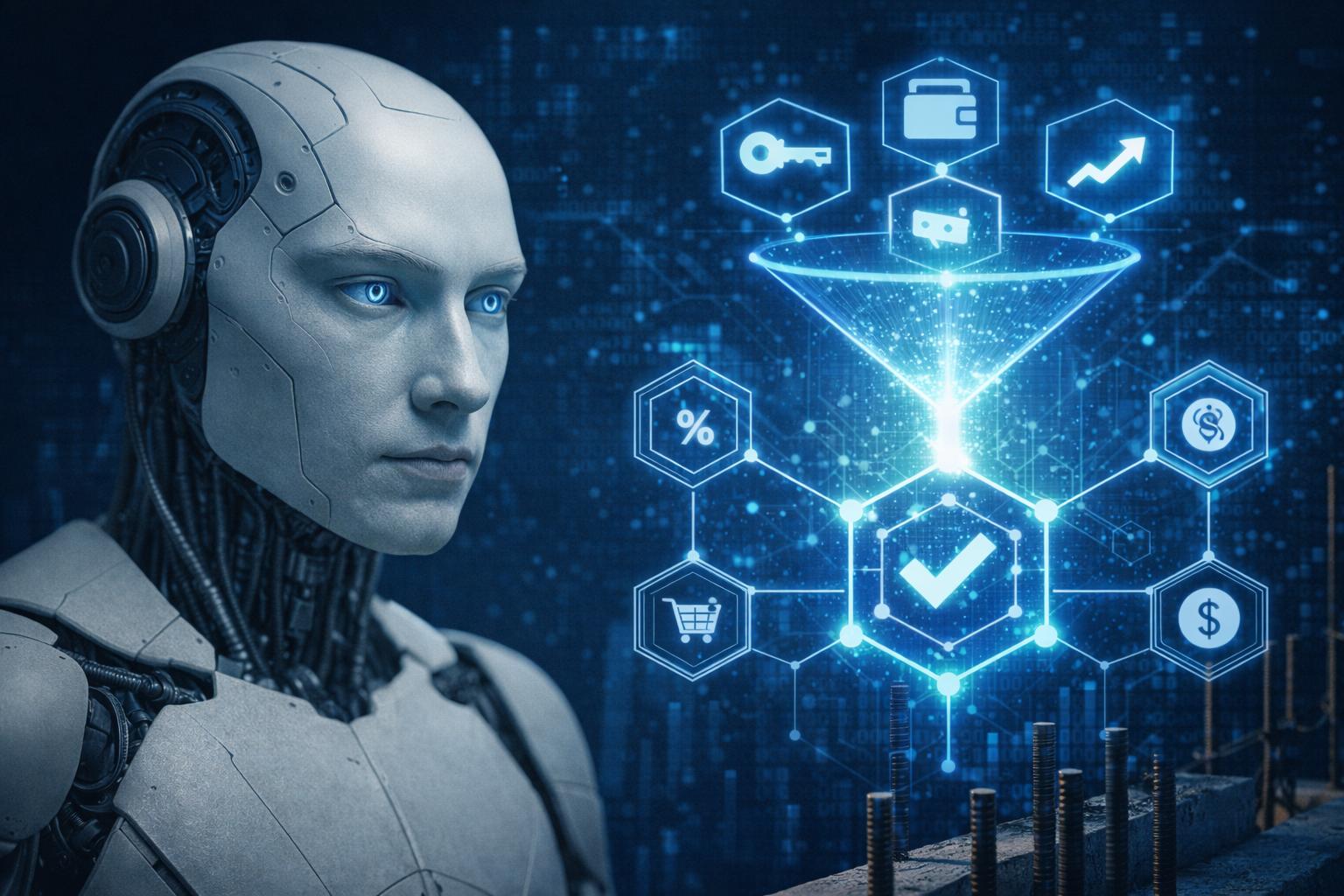Les cryptomonnaies ont constitué des fortunes et, naturellement, différents États se seront penchés sur ce phénomène qui outrepassait largement le cadre informatique. Si plusieurs pays accordent une exonération d’impôt pour tous les titulaires de cryptomonnaies, cela n’est évidemment pas le cas de la fiscalité française qui aura cherché à profiter au mieux de cette nouvelle dynamique afin de capter le plus de recettes possibles.
Les actifs numériques et l’imposition en France
Bien que les cryptomonnaies ont été négligées puis raillées par la puissance publique, l’évolution de la dynamique crypto aura cependant enjoint les différents États à travers le monde à se pencher de plus près sur tout ce qui entourait ce phénomène. Ainsi, la France, malgré un semblant d’hostilité voué à l’endroit des monnaies décentralisées, se sera toutefois satisfaite de prélever des revenus fiscaux issus de nombreuses fortunes érigées depuis les cryptomonnaies.
De ce fait, une case « actifs numériques » a été ajoutée à la fiche d’impôt sur le revenu afin d’y déclarer ses possessions en cryptomonnaies. Celle-ci vise alors à y recenser tous les gains effectués en cryptomonnaies. Ces gens comprenant aussi bien le fruit d’une transaction, le résultat d’un minage de crypto ou bien une quelconque plus-value en actifs crypto.
Les actifs numériques comprennent alors toutes les cryptomonnaies en circulation, indépendamment de leur nature. Il n’existe par exemple pas de régime fiscal spécialement attribué aux shitcoins ; tous les tokens sont logés à la même enseigne.
Le taux d’imposition sur ce qu’il convient d’appeler les actifs crypto s’élève alors à 30 % de la plus-value effectuée durant une année donnée.
L’imposition sur les cryptomonnaies nécessite-t-elle d’avoir retiré ses gains ?
Contrairement à une idée reçue, les actifs crypto sont amenés à être déclarés non pas à compter de l’instant où ceux-ci ont été convertis en euros sur un compte en banque, mais dès l’instant où vous entrerez en possession de ceux-ci sur une plateforme de trading.
Lire aussi : Quelles différences entre le PoS (preuve d’enjeu) ou le PoW (preuve de travail) ?
L’imposition des cryptomonnaies, en effet, se focalise autour de la plus-value effectuée dans le cadre des activités liées aux actifs crypto. Aussi, cette plus-value ne pouvant qu’être effectué que via les canaux de la blockchains, l’État a ainsi considéré que l’imposition était de rigueur à compter de l’instant où des actifs étaient détenus sur un portefeuille numérique et ce, quelle qu’en soit sa provenance.
L’imposition sur les cryptomonnaies, une notion en évolution constante
Compte tenu du caractère récent des cryptomonnaies, le droit fiscal se réadapte constamment pour s’adapter à la réalité du terrain. Ainsi, les normes se rapportant à la fiscalité sur les cryptomonnaies en France sont amenées à évoluer constamment.
Aussi, le fait que les cryptomonnaies soient 100 % décentralisées pour certaines d’entre elles incitent certains utilisateurs à avoir recours à des moyens détourner pour se soustraire à l’impôt. Beaucoup utilisent ainsi des VPN pour se rendre sur une plateforme de trading, d’une cryptomonnaie comme Monero pour que leurs échanges passent inaperçus et cherchent à transcrire leurs gains dans une banque étrangère où les cryptomonnaies ne sont pas soumises à l’imposition.
Ces manœuvres, toutefois, s’apparentent à de l’évasion fiscale et exposent ceux y ayant recours à d’éventuelles poursuites judiciaires.